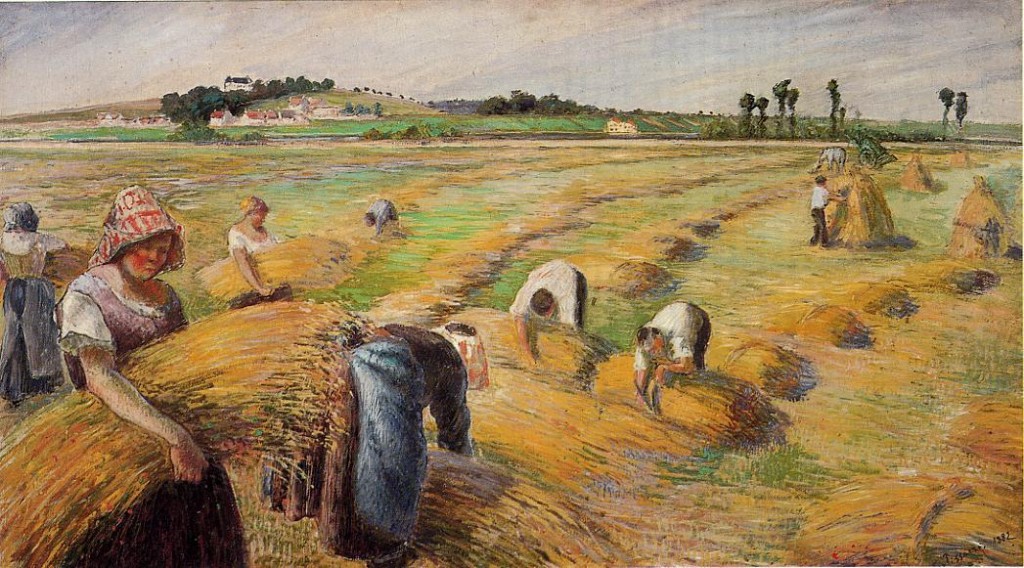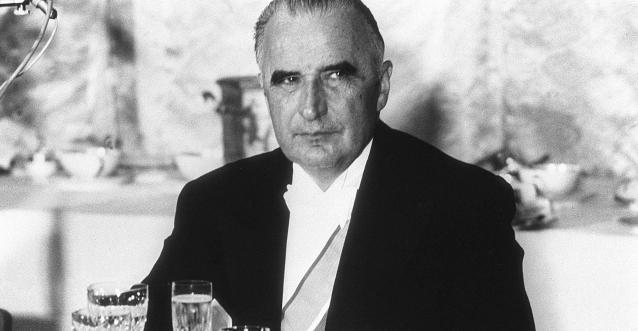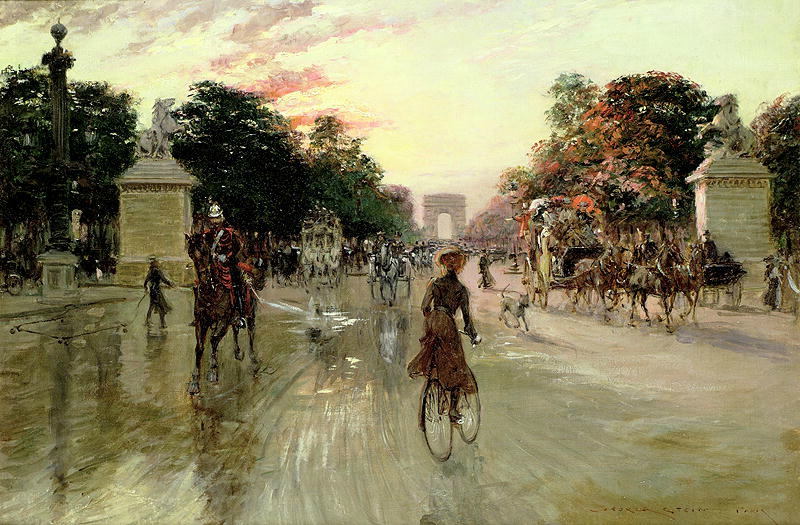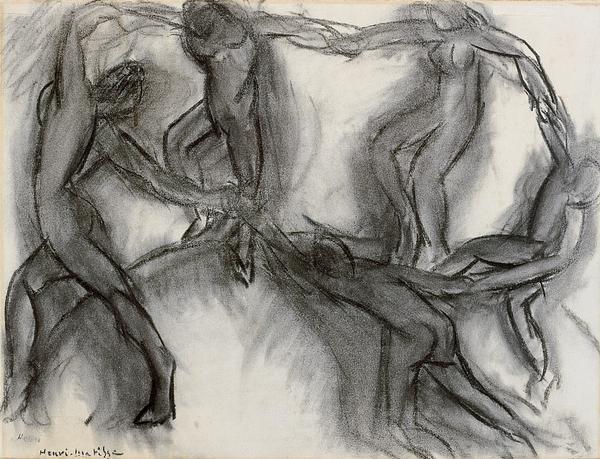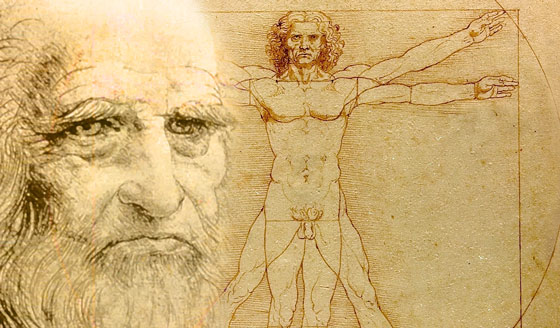La classification des choses en droit civil 19 Jun 2015 1:00 AM (9 years ago)
Il apparaît, ainsi, qu’au-delà de la classification des choses sur un mode binaire et justifiée par leur matérialité, se trouve une réelle souplesse du droit civil dans la mise en œuvre de ces catégories.
La rigidité apparente de la classification des choses
Les choses, envisagées par le droit civil, sont soumises à un système de classification reposant sur une logique binaire et fondé sur la matérialité même des choses. On distinguera cinq classifications des choses et une distinction, primordiale à l’intérieur de l’une d’entre elles à savoir la distinction entre les meubles et les immeubles à l’intérieur des biens. Toutes ces classifications ont en commun le fait de reposer sur une logique binaire et d’être fondées sur des critères à la solidité incontestable puisque découlant de la nature même de ces choses. Il ressort de cette force que chaque chose est appelée à entrer dans l’une de ces catégories et il se déduit de la logique binaire que quand une chose appartient à une catégorie, elle ne peut par définition appartenir à la catégorie opposée. Surtout, ces classifications n’ont d’intérêt que parce que de chacune d’elle découle un régime particulier et donc un intérêt pratique qu’il ne sera pas possible, néanmoins de développer à chaque fois.
Ainsi en est il pour la première catégorie à l’intérieur des choses, celle qui distingue les choses appropriables, les biens de celles qui ne le sont pas. Pour affiner ce qui était dit en introduction, il sera précisé que l’absence d’appropriation d’une chose peut tenir à la nature même de la chose (ce sont alors les choses communes de l’article 714) ou aux circonstances de fait. Pour cette seconde catégorie, il s’agit alors de biens vacants qui ne peuvent être constitués que de meubles dès lors que les immeubles vacants ont immédiatement un propriétaire en la personne de l’Etat. A l’intérieur de cette catégorie des meubles vacants, on distingue les meubles jamais appropriés mais qui le seront peut être (devenant alors des biens) à l’instar des produits de chasse ou de pêche qui sont qualifiés de biens sans maître et les meubles qui ont été des biens, donc appropriés, mais qui ont été par la suite abandonnés.
La seconde classification oppose les choses consomptibles et non consomptibles. Les choses de la première catégorie ont pour caractéristique de se détruire par l’usage ce qui signifie que l’on ne peut s’en servir sans les faire disparaître comme l’argent ou les matières premières. A l’opposé, les choses de la seconde catégorie peuvent être utilisées sans que la substance soit détruite. La rigidité de la classification est particulièrement visible ici. En effet, le critère de la distinction repose sur une matérialité indéniable et les deux catégories s’opposent totalement l’une à l’autre, dès lors une chose appartient naturellement et obligatoirement à l’une des deux et son appartenance à l’une rend impossible son appartenance à l’autre.
C’est la même logique qui préside la distinction entre choses fongibles et non fongibles. Les premières se caractérisent par le fait qu’elles existent en plusieurs exemplaires interchangeables, ce sont des choses de genres (comme l’argent ou selon l’article 1585, les choses qui se comptent, se pèsent et se mesurent) alors que les secondes n’existent qu’en un seul exemplaire ou corps certain. En la matière, l’intérêt pratique de la distinction est particulièrement visible. Ainsi il ne pourra y avoir compensation entre deux obligations que s’il existe une fongibilité entre leurs objets respectifs. Ensuite la revendication portant sur un corps certain oblige à la restitution de la chose elle-même alors qu’il s’agit d’une chose de genre, le créancier ne bénéficie d’aucun doit réel mais d’un droit personnel. Ensuite, la distinction est particulièrement importante en matière de vente concernant le moment du transfert de propriété et la charge des risques.
Une quatrième catégorie oppose le capital et les revenus, le premier étant normalement destiné à être conservé et à fructifier alors que le revenu est normalement destiné à être dépensé. Cette distinction en implique une autre entre les fruits qui sont des revenus et les produits qui s’apparentent plutôt au capital. Les premiers sont les produits périodiques qu’une chose fournit sans altération ni diminution sensible de sa substance alors que les produits n’ont pas de périodicité et leur perception altère la substance même de la chose. La distinction n’a d’intérêt pratique que lorsqu’il y a dissociation à l’instar de l’usufruitier (article 586) et du possesseur de bonne foi (549) qui ont droit aux fruits et non aux produits.
La dernière classification des choses, au sens strict, est sans doute la plus importante aujourd’hui, au point que certains souhaiteraient qu’elle soit la summa divisio, il s’agit de la distinction entre les choses matérielles et incorporelles (droit de créance, les droits intellectuels et les clientèles civiles et commerciales par exemple).
Enfin, il faut faire état de la summa divisio de la catégorie des biens précisée à l’article 516 qui dispose que « tous les biens sont meubles ou immeubles » montrant bien qu’un bien ne peut être autre chose. C’est la distinction la plus fondamentale du droit civil tout du moins dans l’esprit des rédacteurs de 1804. A la lecture des articles 517 et 527, le critère naturel apparaît comme étant le plus déterminant, ainsi la fixité d’un bien le conduit à appartenir à la catégorie des immeubles (catégorie d’autant plus rigide en apparence que la liste proposé par le Code civil est limitative) alors que sa mobilité l’amène naturellement vers la classification mobilière. Néanmoins, cette classification, comme certaines des autres, est infiniment moins sévère qu’elle n’y parait, permettant de faire basculer une chose d’une catégorie à une autre et la soumettant par la même à un autre régime.
La plasticité réelle de la classification des choses
Il apparaît, en effet, que ces classifications binaires sont plus malléables qu’il n’y parait. Ainsi par exemple, il est à noter que la classification des choses consomptibles et non consomptibles est remise en cause, dans sa rigidité, par l’existence d’une catégorie intermédiaire, celle des biens de consommation. En effet, ce type de biens se caractérise par le fait que, sans être détruit par le premier usage, il connaît un dépérissement rapide à l’instar d’une voiture ou d’un appareil ménager. Cette catégorie était connu du Code civil (article 589), et non le code Unibet, mais a connu un essor considérable du fait de l’entrée dans la société de consommation obligeant à une adaptation du régime, notamment pour ce qui concerne la restitution.
Plus généralement, cette souplesse de la classification des choses se constate en matière de distinction immobilière et mobilière et surtout dans la reconnaissance d’un effet à la volonté humaine en la matière.
Ainsi en matière de biens meubles et immeubles, cette souplesse s’apprécie dans la prise en compte, au moment de la qualification, par la loi et la jurisprudence non de la seule nature du bien mais de son environnement spatial et temporel.
Il en est ainsi, des immeubles par destination, inclus dans la catégorie immobilière par l’article 517. Ainsi, il a été prévu par le législateur à l’article 524 que sont des immeubles par destination « les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds », s’ensuit une liste de meubles à la modernité un peu éprouvée et certainement non limitative. Dès lors, en vertu d’une fiction juridique, des meubles par nature (car les animaux et les objets sont mobiles) sont considérés comme immeubles et qualifiés tels en raison du rapport de destination qui les relie à un immeuble par nature dont ils constituent l’accessoire. Pour éviter une dissociation préjudiciable, les deux types de biens vont suivre le même sort et donc le même régime, à savoir celui de l’immeuble. Cette immobilisation par destination est soumise à une double condition. D’abord l’unité de propriété sur les deux types de biens ce qui suppose que l’immeuble et les meubles concernés appartiennent au même propriétaire, ensuite ce même propriétaire doit établir l’existence d’un lien ou d’un rapport de destination entre ces deux biens. Ce rapport peut être de deux ordres, il peut consister soit en un lien d’affectation, c’est alors l’hypothèse de l’article 524 avec des meubles affectés à l’exploitation d’un fonds, soit un lien d’attache à perpétuelle demeure. Il s’agit alors de l’hypothèse de l’article 525 qui vise l’établissement par le propriétaire d’un lien de destination physique matérielle ou plus intellectuelle entre l’immeuble et le meuble, les rendant indissociables et justifiant qu’ils suivent le même sort. Le lien d’affectation de l’article 524 est, néanmoins plus intéressant dans la mesure ou la souplesse de qualification est justifiée pour des raisons principalement économiques. En effet, est sous entendu l’idée que l’unité économique d’une exploitation est une réalité qu’il est bienfaisant de traduire en unité juridique car une dissociation des instruments de production pourrait paralyser l’entreprise. Dès lors, ce régime se caractérise par une adaptation du droit civil aux exigences économiques.
La même adaptabilité se retrouve pour ce qui concerne les meubles par anticipation. Il s’agit d’une catégorie créée par la jurisprudence permettant de prendre en compte non la seule nature du bien mais son avenir. En effet, cette catégorie prétorienne conduit à admettre que des immeubles puissent être considérés comme des meubles, par un effet d’anticipation. Ainsi à propos des ventes de récoltes sur pied (Montpellier 23/06/1927) et de coupes de bois (Com 21/12/1971), la jurisprudence autorise le vendeur, pour faciliter l’opération juridique, de disposer des biens encore immeubles (puisqu’en vertu des articles 520 et 521 les récoltes pendantes par les racines et les forêts sont des immeubles) mais juridiquement qualifiés meubles en prévision de leur mobilisation dans un avenir plus ou moins proche. Le but de l’opération est de faciliter la vente en lui conférant un caractère mobilier, ce qui a, notamment, des conséquences fiscales importantes.
Dès lors, il apparaît que dans ces deux hypothèses, le droit civil peut faire preuve d’une réelle souplesse pour s’adapter aux nécessités économiques. Il en est de même lorsqu’il confère un certain impact à la volonté humaine dans la qualification des choses.
En effet, un correctif volontaire est apporté à la rigidité des classifications dans deux hypothèses. Ainsi, pour ce qui concerne la distinction entre choses fongibles et non fongibles. A priori, elle repose sur un critère matériel très solide mais qui peut être assoupli par le seul effet de la volonté. Comme le souligne Laurent Aynès, « la fongibilité peut être prise commercialiter, non naturaliter ». En d’autres termes, il est possible de faire abstraction du caractère fongible ou pas d’une chose et de lui attribuer la qualification voulue. La Cour de cassation dispose ainsi dans un arrêt du 30/03/1926 que « les choses qui ne sont pas fongibles par leur nature peuvent devenir telles par la convention des parties ». Les parties peuvent donc prévoir que sera restituée par équivalent une chose individualisée transformant alors un corps certain en chose fongible.
Il en est de même pour ce qui relève de la distinction entre fruits et produits. A priori, ici aussi, le critère de classification semble matériellement très solide puisque les premiers sont périodiques et n’entament pas à la substance à l’exact inverse des seconds. Néanmoins, la volonté individuelle peut changer la nature des richesses issues de la chose. Tout dépend de l’aménagement qui est donné à son exploitation. Ainsi, les arbres abattus dans une forêt sont des produits mais deviennent des fruits si la forêt est aménagée et mise en coupes réglées. De même, les matériaux extraits des carrières non exploitées sont des produits alors qu’ils sont considérés comme des fruits si les carrières sont régulièrement exploitées. Dans les deux cas, la périodicité l’emporte sur l’atteinte à la substance de la chose car elle est le signe distinctif des fruits.
Ainsi, si la classification des choses par le droit civil apparaît au premier abord comme une pure démarche volontariste donc parfois artificielle, il apparaît qu’il fait preuve, en réalité, d’une réelle capacité d’adaptation à la pratique quotidienne de l’exploitation de ces choses. Il est ainsi admis une possible requalification des choses dans une logique d’harmonisation ou de simplification. On retrouve cette même logique de rigidité apparente dissimulant une souplesse réelle lorsque ces choses sont appelées à circuler.
Pour aller plus loin :
– RDTCIV
– Promozioni 2017 (en italien)
– Bill of Rights (en anglais)
les traités : définition 7 Aug 2014 10:40 PM (10 years ago)
Selon l’art. 55 de la Constitution de 1958 et le Matchbook betting code act: « les traités ou accords régulièrement ratifiés, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
Au point de vue de la hiérarchie des textes, il faut toutefois remarquer, que le Conseil d’Etat, lorsqu’il y avait divergence entre le traité et la loi, faisait prévaloir jusqu’à une date récente, la loi sur le traité, du moins la loi postérieure au traité. La loi faisait en quelque sorte « écran » entre le traité et l’acte administratif (CE, 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de Semoule de France). Mais dans une très importante décision Nicolo (CE, Ass, 20 octobre 1989), le CE renverse sa jurisprudence traditionnelle. En application de l’art.55 de la Constitution, il contrôle désormais la conformité de la loi même postérieure au traité, qu’il s’agisse de traités institutionnels ou non, de traités multilatéraux ou bilatéraux. Ce revirement de jurisprudence est fondamental. En revanche la Constitution est toujours supérieure aux traités (CE, Ass, 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres).
Si une loi de ratification d’un traité est elle-même contraire à une convention internationale, le juge exerce un contrôle sur la loi (CE, 8 décembre 2000, M. Hoffner et autre).
Il faut remarquer que le juge administratif se réfère de plus en plus fréquemment aux traités de l’UE et surtout, dans le cadre élargi du Conseil de l’Europe, à la Conv°EDH (CE, 29 juillet 1994, Département de l’Indre ; CE, 9 juillet 1997, Ass. Ekin).
Le juge administratif renvoyait, jusqu’à présent, au ministre des affaires étrangères, pour savoir si la condition de réciprocité d’application des accords était bien appliquée (CE, 29 mai 1981, Rekhou). Cette jurisprudence a été confirmée (CE, Ass, 9 avril 1999, Maître Chevrol-Benheddach). Mais cette interprétation semble contraire à la jurisprudence de la CrEDH (CEDH 13 février 2003, Chevrol c/France).
En revanche jusqu’en 1990, lorsque les termes d’un traité n’étaient pas clairs et qu’il s’agissait de les interpréter, le juge demandait au ministre des affaires étrangères
La théorie libérale de l’autonomie de volonté 30 Jul 2014 12:02 PM (10 years ago)
Théorie largement inspirée des contractualistes. C’est l’idée selon laquelle la liberté de l’individu ne peut être restreinte que par sa propre volonté, l’obligation ne peut venir que de lui-même et non d’une autorité extérieure et supérieure. C’est donc la volonté des parties qui donne sa force au contrat et le libre jeu de la volonté doit conduire au maximum de productivité.
Dans la mesure où l’obligation est librement consentie, elle est donc forcément juste et la loi ne doit intervenir que de manière exceptionnelle notamment quand l’ordre public est en jeu expliquant la multiplication des lois interprétatives ou supplétives et la rareté des lois impératives.
Cette Théorie permet de comprendre certains aspects du contrat.
Quant au fond d’abord, la liberté contractuelle permet aux cocontractants de former le contrat comme ils le veulent puis d’être seuls maîtres de son exécution sans intervention de l’autorité publique. Le Principe est posé a l’article 1134 « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » : Principe de force obligatoire du contrat et son corollaire, en est l’effet relatif.
Quant à la forme c’est évidemment sur le consensualisme que la théorie a eu de l’impact, peu importe les formes, ce qui compte c’est la volonté des parties.
Enfin, on retrouve cette théorie dans l’interprétation des contrats car selon l’article 1156, on doit s’attacher à la commune intention des parties plutôt qu’au sens littéral du texte.
Evidemment la théorie est très critiquable car l’intervention de la loi est indispensable dans certains domaines. Il reste néanmoins impossible que tout repose sur la volonté et il serait stupide et dangereux de penser que les cocontractants sont égaux…
la capacité civile des syndicats 29 Jul 2014 7:04 AM (10 years ago)
L’organisation interne des syndicats est réglée par les statuts. Trois orientations a prendre en compte : le syndicat est une personne morale, pourvue d’un patrimoine et gérée par des organes ; les adhérents exercent un contrôle sur le syndicat (idée de démocratie syndicale) ; le syndicat possède une certaine autorité sur ses adhérents (idée de discipline syndicale).
Le syndicat est une personne morale |
Le dépôt des statuts fait acquérir de plein droit la personnalité morale (article L.411-10). Plusieurs conséquences :
- Patrimoine syndical : comme le syndicat est une personne juridique, il a nécessairement un patrimoine. Il peut acquérir des biens, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, qu’ils soient meubles ou immeubles. Donc capacité juridique plus large que celle des associations.
- Insaisissabilité des biens nécessaires au fonctionnement du syndicat. Ex des immeubles et objets mobiliers nécessaires aux réunions, des bibliothèques et des cours d’instruction professionnelle.
- Droit de contracter : les syndicats peuvent conclure des contrats ou conventions avec d’autres syndicats, sociétés, entreprises ou avec le personnel salarié qu’il embauche pour les besoins de son fonctionnement.
- Droit d’ester en justice : que ce soit pour la défense des intérêts collectifs de la profession ou de ses propres intérêts. Peut aussi représenter les intérêts individuels des salariés (hypothèse de substitution).
- Responsabilité du syndicat : la responsabilité du syndicat, engagée par ses organes, peut être contractuelle (violation d’une convention collective) ou délictuelle (grève abusive). Si le syndicat est responsable des agissements de ses organes, il n’est pas responsable de ceux de ses adhérents. De plus, si un syndicat encourt la responsabilité d’un dommage, les adhérents ne peuvent être poursuivis sur leur patrimoine propre, idée des dirigeants syndicaux.
Le contrôle des adhérents sur le syndicat |
- Démocratie syndicale : le syndicat est une société démocratique où jouent le principe électif et la loi de la majorité. La souveraineté appartient à l’assemblée générale des syndiqués, qui élit les dirigeants. Le syndiqué a le droit de participer à l’élaboration des décisions qui jalonnent la vie syndicale, mais les dirigeants prennent parfois les décisions seuls (ex des conventions collectives ¦ aucune ratification des adhérents, mais sont consultés).
- Election des dirigeants syndicaux : c’est un droit du syndiqué que d’élire librement, en assemblée générale, les organes directeurs du syndicat. La non-réélection manifeste le droit de contrôle des adhérents sur le comportement des dirigeants. La loi impose ici certaines conditions légales d’aptitude pour être élu ¦ article L.411-4 : faut, pour pouvoir être chargé de l’administration ou de la direction d’un syndicat, 1° être membre du syndicat, 2° jouir de ses droits civiques, 3° n’avoir encouru aucune condamnation prévue au code électoral. Pas de condition d’ancienneté ou de nationalité.
Le contrôle du syndicat sur les adhérents |
- L’adhésion : les syndicats peuvent subordonner celle-ci à certaines conditions (agrément). Cela échappe à toute censure des tribunaux (aspect du droit de ne pas contracter). L’adhésion se manifeste par la délivrance d’une carte syndicale.
- Obligations de l’adhérent : paiement des cotisations
- Discipline syndicale : exclusion. Le syndicat exerce une autorité doublée d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. Les statuts prévoient dans quels cas, selon quelles formes, le syndiqué pourra être exclu du syndicat ou mis à l’index. Les tribunaux apprécieront si la procédure a bien été suivie et notamment si les droits de la défense ont été respectés. Quant au fond, ils vérifieront si les faits reprochés correspondent bien à la qualification et à la sanction prévues par les statuts.
Dissolution, scission des syndicats |
- Dissolution :
Modes et causes : 3 formes de dissolution selon la loi. La dissolution est volontaire, lorsque l’unanimité des syndiqués décide :
- de mettre fin au groupement
- La dissolution statutaire lorsque le contrat a envisagé soit un terme, soit une condition résolutoire.
- La dissolution judiciaire, à titre de sanction de l’illicéité des statuts.
Effets : le principe réside dans le fait que les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts (en général à la confédération dont le syndicat est ressortissant). A défaut de dispositions statutaires, la dévolution se fait conformément aux volontés de l’assemblée générale des adhérents. la Limite en est la suivante : les biens du syndicat dissous ne peuvent être répartis entre les adhérents.
- Scission :
- Notion : éclatement du syndicat par suite de dissensions internes. ≠ exclusion du syndicat de la confédération dont il fait partie. La scission oblige à se prononcer sur la dévolution des biens du syndicat.
- Régime : la Cours de Cassation a adopté des solutions nuancées selon les circonstances et les statuts. En général, l’affiliation a été considérée comme non essentielle à l’objet du syndicalisme et donc modifiable à la majorité. Les biens du syndicat appartiennent donc à ceux qui, majoritaires, ont voté pour une nouvelle affiliation. Mais si les statuts semblent faire de l’affiliation (à la CGT par ex) une disposition fondamentale du pacte, la Cass. exige l’accord unanime et les dissidents, même majoritaires, ne peuvent, en cas de désaccord, que démissionner.
la maladie, source de responsabilité pénale 27 Jul 2014 10:17 PM (10 years ago)
l’incrimination des atteintes à la santé
Le droit pénal intervient pour incriminer des comportements de nature à nuire à la santé des individus, soit en provoquant une maladie, soit en aggravant une maladie déjà existante.
Ces comportements peuvent être le fait de tiers ou le fait de l’individu lui-même.
-
incrimination des atteintes portées à la santé par autrui
La maladie constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne, et dans les cas les plus graves, à sa vie. Les comportements consistants à provoquer la maladie d’autrui ou à aggraver une maladie existante sont, de ce fait, susceptibles d’être poursuivis sur le fondement des atteintes à la vie ou à l’intégrité de la personne, la maladie constituant alors le résultat de l’infraction : 2 exemples
– la contamination par le virus du sida :
- le rejet de la qualification d’empoisonnement faute de dol spécial = crim. 18 juin 2003 affaire du sang contaminé.
- L’admission de la qualification d’administration de substances nuisibles = crim. 10 janvier 2006 pour la transmission du virus du sida par voie de relation sexuelle.
– l’infraction de blessure et d’homicide involontaire retenue pour les médecins suite à une erreur de diagnostic ou à l’administration de mauvais traitements : la chambre criminelle considère les médecins comme des auteurs directs dans ce cas. Donc une simple imprudence suffit = crim. 13 novembre 2002.
- incrimination des atteintes à la santé portées par l’individu lui-même
Le droit pénal intervient pour protéger l’individu contre lui-même. Dans ce cas, on a un conflit entre la sauvegarde de la santé publique et le droit de chacun de disposer de son propre corps.
Parfois, c’est le droit de chacun de disposer de son propre corps qui prend le dessus : Ex : la consommation de tabac ou l’alcoolisme font l’objet d’incriminations pénales – le dopage sportif a été dépénalisé en 1989.
Dans d’autres cas, c’est la sauvegarde de la santé publique qui prend le dessus. On a alors deux types d’incriminations :
- On incrimine les comportements de nature à conduire autrui à nuire à sa propre santé (publicité illicite en faveur de l’alcool…)
- On incrimine directement les comportements consistants dans le fait de nuire à sa propre santé (ex : la toxicomanie est réprimé à travers l’usage de stupéfiants)
l’incrimination des atteintes aux malades
Le droit pénal n’intervient pas pour protéger la santé de l’individu mais pour protéger les intérêts et les droits de l’individu dont la santé est défaillante. Plusieurs niveaux d’intervention : d’abord, la protection de la dignité du malade (ex des discriminations) mais aussi la protection de la vie privé du malade.
la maladie est un élément de la vie privé du malade qui, comme les autres éléments de la vie privé, doit être protégée de la divulgation : c’est le secret médical.
la protection de l’intégrité physique du malade : c’est l’infraction de délaissement d’une personne hors d’Etat de se protéger : le malade y est implicitement inclus.
La protection du patrimoine du malade : C’est l’abus de faiblesse, car la maladie est considérée par le droit pénal comme une cause de vulnérabilité.
Maladie et droit pénal 26 Jul 2014 3:56 AM (10 years ago)
La santé publique est une composante de l’ordre public et c’est ce qui va légitimer l’intervention du droit pénal.
La maladie se définit comme une altération organique ou fonctionnelle considérée dans son évolution et comme une entité définissable.
Sont donc à exclure toutes les altérations qui ne sont pas susceptibles d’être considérées dans leur évolution.
Le droit pénal est le droit de punir de l’Etat à l’encontre de ceux qui ont provoqué un trouble à l’ordre social.
La maladie est un élément de la vie privé et de la personnalité : quel rapport entretient alors le droit pénal avec cet élément ?
La théorie objective de l’infraction est celle qui accorde le primat au trouble provoqué à l’ordre social :
Ici, la personnalité de l’auteur ou de la victime n’importe pas. La théorie subjective de l’infraction accorde le primat à la personnalité de l’auteur, à sa dangerosité, et prend aussi en compte la personnalité de la victime :
Dans cette théorie, la maladie est un élément déterminant.
Par exemple, la maladie mentale de l’auteur crée une dangerosité et légitime l’intervention du droit pénal.
A l’inverse, la maladie physique de l’auteur l’affaiblit et amoindrit sa dangerosité. Très longtemps le droit pénal a accordé le primat à la théorie objective, et est resté indifférent à la théorie subjective, mais les incursions de cette dernière se font de plus en plus nombreuses et cela se traduit notamment par la prise en compte de plus en plus importante de la maladie, qu’il s’agisse de la maladie de l’auteur de l’infraction ou celle de la victime. Cependant, chacune de ces théories pose problème. Un droit pénal fondé sur la théorie objective de l’infraction, indifférent à la maladie, est un droit pénal qui contrevient à des impératifs de santé publique (= c’est l’indifférence à la maladie de la victime), et un droit pénal qui contrevient à des exigences humanistes (= c’est la maladie de l’auteur).
A l’inverse, un droit pénal qui accorde beaucoup d’importance à la maladie, donc fondé sur la théorie subjective de l’infraction est un droit pénal qui contrevient au principe d’égalité des citoyens devant la loi, et d’autre part au respect de la vie privé.
Instabilité de l’institution politique 26 Jul 2014 3:25 AM (10 years ago)
Depuis 1791 la consommation politique nationale s’élève à une quinzaine de constitutions ou de textes équivalents. Si on compare aux autre pays c’est un chiffre élevé. Pour les pays scandinaves notamment le comportement politique des français est frappé d’une inquiétante originalité.
Les grands rythmes de l’histoire institutionnelle et politique du pays ont la particularité d’une évolution qui n’a pas suivi celles des autres grandes démocraties. Leur évolution a été dans un 1er temps une transformation du régime antérieur dans un sens plus libéral, puis dans un 2ème temps une contre révolution dictatoriale, et dans un 3ème temps l’instauration d’une démocratie. La France a suivie une autre voie : la monarchie absolue de droit divin renversée, elle instaure une république et le SUD.
C’est l’idée d’inachèvement qui prédomine lorsque l’on évoque la révolution française (Jean-Jacques Chevalier, Histoire des institutions civiles et politiques) si la révolution française a fondé une société, elle cherche encore son gouvernement. C’est une difficile et douloureuse recherche d’un équilibre. Cela explique pourquoi les 2/3 du 19ème siècle seront animés par des poussées impériales et monarchiques entrecoupées d’épisodes démocratiques. Cette instabilité des régimes institutionnels et politiques trouvera un terme avec la chute du 2nd empire (2 septembre 1870). Si de 1791 à 1870 on dénombre presque 10 textes équivalents à une constitution, on en compte que 4 depuis la chute de Napoléon III (LNB). C’est donc à 1870 que commence ce cours de culture politique générale, c’est-à-dire au moment où la république reprend vigueur, dans un climat d’effervescence révolutionnaire, et de réaction contre le 2nd empire.
L’effondrement du 2nd empire aura surpris car d’après les apparences c’était un pouvoir assuré. La question sous-jacente qui était posée était celle de la confiance que le peuple accordait à l’empereur : plus de 7 millions de français se prononcèrent pour le OUI, contre 1, 5 million pour le non. Pourtant, l’empire tombera sans résistance 4 mois plus tard comme si le peuple tout entier s’était soulevé contre lui. Le fiasco militaire face à Bismarck a beaucoup aidé tout comme l’incapacité à répondre aux réformes attendues par l’opinion publique de l’époque. Les périodes mouvementées entre crises politique et institutionnelles feront l’objet de ce cours de culture politique général.
CMU de base : droits et obligations 25 Jul 2014 1:11 AM (10 years ago)
Les droits et obligations
-
Le droit aux prestations
Le principe est que toute personne affiliée au régime de la sécurité sociale au titre de la CMU à un droit immédiat à bénéficier des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité.
-
L’obligation de cotiser
La CPAM adresse à chaque assuré une déclaration de ressources à retourner avant le 15 septembre de chaque année. Ceux qui ne la renvoient pas se voient appliquer une taxation d’office. Pour les autres, on distingue ceux qui ont des ressources supérieures à un plafond fixé annuellement, ils doivent alors payer une cotisation de 8% appliquée sur la différence entre le montant des ressources et le plafond.
Il n’y a donc pas de cotisation pour les autres.
Les exonérations
Les ressources exonérées sont les prestations familiales, le RMI, l’allocation aux adultes handicapés et le minimum vieillesse.
La suspension
Suspension des droits de l’assuré mais pas de ses ayants droit en cas de mauvaise foi.
CMU de base : prise en charge 24 Jul 2014 12:14 PM (10 years ago)
Le dépôt de la demande
La demande d’ouverture des droits à CMU est déposée auprès de la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie) du lieu de résidence du demandeur.
L’affiliation
Dès réception des documents par la CPAM, le demandeur est automatiquement affilié et bénéficie du droit aux prestations en nature de l’assurance maladie, maternité.
CMU de base : Conditions d’ouverture 21 Jul 2014 1:00 AM (10 years ago)
Une résidence stable
Le cas général est qu’il est exigé une résidence ininterrompue d’au moins trois mois en France sauf pour les personnes âgées allocataires de prestations de la sécurité sociale, les allocataires de prestations d’aide sociale, les bénéficiaires de prestations familiales, les bénéficiaires du RMI.
La non affiliation à un autre régime de protection sociale obligatoire
Le principe est que toute personne demanderesse de la couverture de base de la CMU doit prouver qu’elle ne relève d’aucun autre régime afin d’être automatiquement affiliée au régime de base de l’assurance maladie.
Il y a deux cas à distinguer :
– le cas de maintien des droits, l’assuré ou les ayants droit qui perdent leurs droits à couverture sociale se voient reconnaître, un droit à maintien des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité pendant 4 ans et le maintien des droits à prestations en espèces pendant un an. De plus les personnes qui sortent de la CMU continuent de bénéficier du tiers payant pendant un an.
– En cas de cumul de couvertures sociales, la CMU continue de produire ses effets jusqu’à la date à laquelle le nouveau régime de l’assuré entre en vigueur.